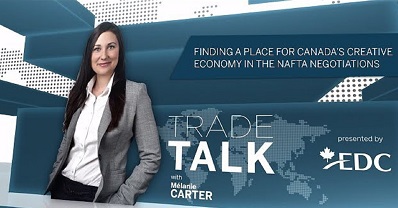Les politiques étrangères américaines reposent en grande partie sur l’exportation de l’idéologie culturelle des États-Unis et bien que les Canadiens apprécient volontiers les scénarios hollywoodiens et les rythmes de Nashville, de la Nouvelle-Orléans et de Détroit, il ne fait pas de doute que si nous voulons garder bien vivante l’unicité de notre rêve national, nous devons en tout temps demeurer conscients de la présence du « piège de velours » qui nous guette au sud de la frontière.
Mais de nos jours, l’ère du numérique nous envahit avec toutes ses merveilles et ses commodités. Cependant, les propos de l’ancien premier ministre Pierre Trudeau demeurent aussi pertinents qu’en 1969, alors qu’il taquinait en ces mots le Washington Press Club :
Être votre voisin, c’est comme dormir avec un éléphant… la bête a beau être douce et placide, on subit chacun de ses mouvements et de ses grognements.
Et la lutte à la préservation d’une identité ne saurait être plus clairement ciblée qu’au Québec, qui se retrouve seul sur un continent où vivent près de 300 millions d’anglophones.
Le grand linguiste, philosophe et historien Noam Chomsky soutient que la langue est plus qu’un outil de communication, puisqu’elle constitue, selon lui, un moyen de « préservation d’un espace social sécuritaire ». C’est le véhicule qui nous sert à partager nos points communs, à transmettre la sagesse de nos ancêtres, à dire à notre grand-mère que nous l’aimons et à nous définir en tant que communauté. Si la lutte à livrer pour préserver nos valeurs et tracer un parcours vers un avenir qui nous est propre est difficile pour les Anglo-Canadiens, le défi est beaucoup plus grand pour les Franco-Canadiens, qui dorment à la fois avec l’éléphant et avec la souris.
Aujourd’hui, les producteurs de contenu de chacune des « Deux solitudes » du Canada partagent cette « aire de l’anxiété » à l’heure où nous suivons tous de très près les pourparlers actuels en lien avec l’ALENA.
La culture est le visiteur indésirable à la table de l’ALENA. Elle ne fait pas partie du programme, mais sa présence se fait clairement sentir. Mme Meredith Lilly, Ph. D., professeure adjointe à l’École Norman Paterson des Affaires internationales de l’Université Carleton et observatrice lors de la récente ronde de Washington, a déclaré :
Les industries culturelles américaines font pressions dans les coulisses pour faire de la culture un sujet de discussion.
Les États-Unis ont toujours été irrités par l’entêtement avec lequel le Canada se porte à la défense de sa culture. Comme l’indique Mme Lilly, « cela leur déplaît et leur a toujours déplu. »
Et il s’agit là d’une doléance de longue date.
Il y a longtemps, lorsque la radio était une toute nouvelle technologie aussi enlevante et prometteuse qu’Internet peut l’être de nos jours, les barons des médias des années 1930, depuis leurs gratte-ciel de Manhattan, avaient déjà compris que les auditeurs canadiens constituaient un nouveau marché en pleine croissance. Après tout, rares étaient ceux qui n’aimaient pas Amos et Andy.
Un jour, conformément à la tradition canadienne, une commission royale a été créée pour étudier les implications de cette alarmante technologie. Présidée par Sir John Aird, président de la Banque de commerce, cette commission, à l’origine du Rapport Aird, a formulé une bien audacieuse recommandation : l’ensemble de la diffusion au Canada devait être organisée sous forme de service public national. Comme le déclarait un témoin de l’époque :
La liberté ne peut être complète, ni la démocratie suprême, si les intérêts commerciaux dominent cette ressource vaste et majestueuse de radiodiffusion.
Au fil des décennies, des gouvernements de toutes les convictions se sont montrés à l’écoute.
Radio-Canada, l’Office national du film, le CRTC, les prix Juno, le Fonds des médias du Canada, le BCPAC et les systèmes provinciaux de crédit d’impôt… à de nombreuses reprises, nos politiciens sont intervenus dans l’arène culturelle pour partager leur conviction suivant laquelle la démocratie canadienne est mieux servie lorsque nous contrôlons le récit de notre histoire plutôt que de laisser le soin aux entrepreneurs new-yorkais ou hollywoodiens le faire.
Mais maintenant, du moins, à ce qu’on nous dit, les anciennes façons de faire reviennent au goût du jour et la façon dont les Canadiens protègent leur culture est sur la table. Les démarches de renégociation de l’ALENA inquiètent les agriculteurs, les forestiers et les travailleurs de l’industrie de l’automobile. Or, peut-être que les auteurs, les musiciens et les producteurs de films seront les prochains?
Depuis 30 ans, le Canada a bâti une dynamique communauté culturelle protégée, en grande partie, par une série d’exemptions culturelles qui faisaient partie de l’Accord de libre-échange original de 1987 avec les États-Unis.
Ces exemptions ont donné naissance au cadre financier qui a permis à une génération de créateurs canadiens de prendre leur envol et d’exporter du contenu dans le monde entier. L’Accord de libre-échange aura représenté une victoire importante pour les exportateurs culturels canadiens et des dizaines de milliers de Canadiens ont profité, depuis lors, de la résilience et de l’habileté de nos négociateurs.
Les quotas de diffusion, les subventions financières, les investissements des contribuables dans les organismes publics (comme Radio-Canada, l’ONF, TVOntario, etc.), de même que les règlements qui régissent les distributeurs contribuent financièrement à la production d’émissions télévisuelles et de films en protégeant les producteurs contre la libre concurrence du marché. Ils ont su tenir les Américains à l’écart et contribuer à la croissance d’une industrie.
Mais le lobby du divertissement est l’un des plus puissants aux États-Unis et les mesures fiscales incitatives fédérales et provinciales très prisées constituent une cible évidente. Ces crédits d’impôt, qui, dans certains cas, permettent au producteur de récupérer la moitié des coûts liés à une production admissible, ont déplacé des centaines de productions au nord de la frontière. Cependant, à l’heure actuelle, de nombreux États du Sud (Géorgie, Alabama, Louisiane, Caroline du Sud, etc.) commencent, eux aussi, à offrir leurs propres crédits d’impôt. De plus, par un retournement de situation qui inquiète les producteurs canadiens, ces États risquent aussi de bénéficier de l’écoute de l’administration.
En 1997, la production cinématographique étrangère au Canada était pratiquement moribonde. La Colombie-Britannique et l’Ontario affichaient une croissance annuelle de leur PIB d’à peine 3 %. L’année suivante, cependant, la production en Ontario a prodigieusement bondi de 65 % et celle de la Colombie-Britannique a affiché un taux de croissance annuel de 55 %, faisant dire au Vancouver sun: « IT’S A BILLION DOLLAR, BABY! ». Le grand responsable aura évidemment été le crédit d’impôt provincial à la production. Conformément à la plus pure tradition de la Commission royale Aird, deux générations auparavant, le gouvernement était intervenu dans le libre marché pour faire pencher la table en direction du Canada.
D’autres provinces ont vite emboîté le pas : le Québec, le Nouveau-Brunswick, la Saskatchewan, la Nouvelle-Écosse et le Manitoba ont tous introduit leurs propres crédits d’impôt. En fait, durant la première décennie des années 2000, on a pratiquement assisté à un concours entre les provinces à savoir qui allait attirer le plus grand nombre de productions étrangères (principalement américaines). Au Canada anglais, le Manitoba a remporté la palme en offrant un attrayant rabais de 65 % des coûts provinciaux admissibles. Alors la prochaine fois où vous entendrez dire que Brad Pitt tourne un film à Winnipeg en plein mois de janvier, vous saurez pourquoi.
Mais nous sommes actuellement à l’ère Netflix. L’arrivée des services numériques par contournement (OTT ou over-the-top) est venue bouleverser l’échafaudage culturel du Canada. Le gouvernement du Canada a fait preuve de proactivité pour s’attaquer à plusieurs des préoccupations des producteurs culturels canadiens par son récent rapport Pour un Canada créatif, qui présente en détail :
- une majoration, par le gouvernement fédéral, des sommes accordées au Fonds des médias du Canada pour la production à compter de 2018, afin de contrer la diminution des investissements du secteur privé;
- un investissement de 125 M$ dans une stratégie d’exportation créative incluant le lancement d’un fonds d’exportation pour favoriser la reconnaissance des créateurs canadiens à l’étranger et la création d’un Conseil des industries créatives;
- la modernisation des programmes de financement comme le Fonds de la musique du Canada et le Fonds du livre du Canada;
- la réforme de la Commission du droit d’auteur du Canada et la révision de la Loi sur le droit d’auteur, en mettant en évidence la protection des droits des créateurs.
Le gouvernement a également promis plus d’argent pour Radio-Canada, un engagement au nom de Netflix à l’endroit d’un investissement de 500 G$ en contenu canadien, l’établissement d’un incubateur Facebook/Université Ryerson sur les médias numériques et la révision de la Loi sur la radiodiffusion et de la Loi sur les télécommunications du Canada.
Cependant, à l’heure où nous nous penchons sur le nouveau paysage médiatique, bien des yeux sont tournés vers les pourparlers entourant l’ALENA et les producteurs sont sur les dents en voyant que les rumeurs sur l’intense lobbying de l’industrie du spectacle à Washington se confirment.
Mme Meredith Lilly a observé les discussions en coulisse :
QUESTION : La culture est-elle vulnérable dans le cadre des actuels pourparlers en lien avec l’ALENA?
« La bonne nouvelle à propos de la culture c’est qu’elle n’est pas encore à l’ordre du jour, du moins, pour le moment. Nous n’entendons pas le président Trump en parler. Cependant, les Américains n’ont jamais aimé nos nouvelles exceptions culturelles, alors je ne serais pas surprise si des discussions avaient lieu dans ce domaine.
Les États-Unis n’ont jamais apprécié qu’on leur impose des limites sur leurs exportations de produits culturels. Ils ont un lobby puissant et très sophistiqué qui désire exporter de plus en plus. Alors les limites qu’impose le Canada, à l’égard des exigences en matière de contenu canadien ou des sociétés d’État qui protègent la culture canadienne seront toujours problématiques pour les Américains.
Les négociateurs discutent aussi d’un « chapitre sur le numérique » qui serait intégré à la nouvelle entente et il y aura assurément des changements dans l’univers de la propriété intellectuelle. Certains créateurs canadiens seront contents de ces changements, et d’autres non.
Il reste beaucoup de choses à voir. »